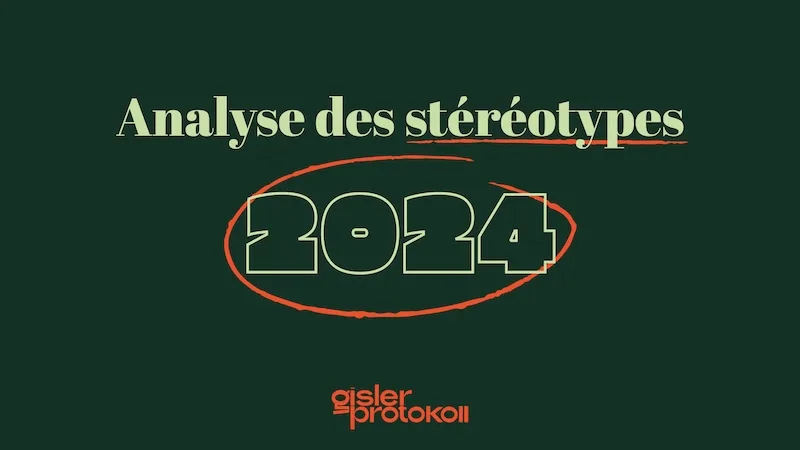Les choses avancent dans le paysage publicitaire suisse. Réalisée pour la quatrième fois par l’association Protocole Gisler, l’analyse des stéréotypes révèle pour la première fois en 2024 un net recul du nombre de stéréotypes de genre.
Les stéréotypes : une inversion des rôles
Sur les 300 spots analysés, seuls 16 % comportaient des stéréotypes masculins ou féminins. Pour Nina Bieli, présidente du Protocole Gisler, l’une des raisons de ce recul réside dans une réflexion plus consciente concernant les stéréotypes de genre : « Ce que nous avons vu beaucoup plus souvent cette année, c’est que les entreprises et les agences utilisent encore ici et là des stéréotypes, par exemple un expert perçu comme masculin qui explique quelque chose au public, mais qu’elles les contrebalancent immédiatement par un équivalent féminin. Pour nous, c’est un signe que l’utilisation de stéréotypes fait l’objet d’une réflexion plus approfondie et qu’elle est davantage consciente ».
Ceci a également pour conséquence que les stéréotypes masculins et féminins les plus populaires sont plus souvent appliqués à l’autre sexe. En d’autres termes : le nombre de spots dans lesquels une personne perçue comme une femme ou perçue comme un homme s’occupe de quelque chose s’équilibre (10 contre 12 spots), il en va de même pour les personnes ayant un statut expert, bien que les personnes perçues comme des hommes soient encore un peu plus nombreuses dans ce rôle (expertes : 15 spots ; experts : 22 spots). Seule la catégorie « humour » est encore clairement dominé par les hommes. Dans seulement 2 des spots analysés, on pouvait voir une personne perçue comme une femme dans un rôle humoristique.
« Nous nous réjouissons de cette évolution positive. Les personnes perçues au masculin et au féminin se voient attribuer davantage de facettes, la publicité se diversifie en termes de rôles des genres. Cela souligne une fois de plus le message que le Protocole Gisler défend depuis le début : il ne s’agit pas pour nous d’interdire l’utilisation de stéréotypes, mais de prendre conscience, en tant que branche, des représentations de genre non remises en question que nous reproduisons sans cesse à travers notre travail. Il s’agit aussi de les utiliser moins souvent et, si nous le faisons, de manière plus réfléchie. Ceci signifie souvent qu’un stéréotype est aussitôt brisé. Notre objectif, la rupture des clichés, devient donc de plus en plus souvent une réalité », explique Nina Bieli.
Au-delà du genre : qu’en est-il ?
Cette année, l’analyse des stéréotypes s’est à nouveau penchée sur d’autres dimensions de la diversité. Il a été relevé à quelle fréquence les relations de couple non-hétérosexuelles (orientation sexuelle), les personnes genderqueer (identité sexuelle) ainsi que les personnes perçues comme non-blanches (origine) étaient représentées. Nous avons également analysé la fréquence à laquelle les personnes seniors étaient représentées (âge). Pour toutes les dimensions, nous avons relevé les rôles dans lesquels ces personnes étaient représentées.
Les couples homosexuels ont été représentés dans 6 spots. Au total, 56 situations de couples (hétérosexuels et homosexuels) ont été représentées. Cela signifie que dans environ 10 % des cas, une situation de couple homosexuel a été montrée, ce qui correspond statistiquement à peu près à la réalité (hypothèse : 3-10 % de la population s’identifie comme homosexuel·le3).
Des personnes genderqueer sont présentes dans 2 spots, ce qui ne correspond même pas à 1 % des spots. Dans un de ces deux spots, une personne genderqueer joue un rôle principal. Selon une étude de l’institut de sondage Ipsos4, 13 % de la population suisse s’identifie comme faisant partie de la communauté LGBTQ+, une représentativité adéquate est donc loin d’être assurée.
Les personnes perçues comme non-blanches sont apparues dans 52 spots (ce qui correspond à 17 % des spots analysés), elles jouent un rôle principal dans 21 d’entre eux. Une évaluation quantitative de la représentation des personnes perçues comme non-blanches n’est pas possible sans une enquête supplémentaire, car les données à ce sujet manquent pour la Suisse. C’est pourquoi l’analyse se concentre davantage sur les caractéristiques qualitatives : par rapport à l’année précédente, le nombre de personnes perçues comme non-blanches dans les spots analysés a légèrement diminué. La proportion de rôles principaux est restée similaire. Il s’avère toutefois que les personnes perçues comme non-blanches ont plus souvent joué un rôle principal, et ce, même sans statut de célébrité et sans lien avec le thème abordé (p. ex. aide au développement).
Des personnes seniors (à partir de plus de 70 ans dans l’analyse) ont été montrées dans 45 des spots analysés (15 % des spots), elles ont joué le rôle principal dans 22 d’entre eux. En Suisse, les plus de 65 ans représentent 19,3 % de la population5. La représentation quantitative des seniors dans la publicité suisse est donc acquise. Leur image qualitative est également positive : les personnes seniors sont présentées comme pleines de vitalité et intéressées par la vie.
« L’analyse a révélé que de nombreuses entreprises mettent en œuvre une communication davantage diversifiée en ce qui concerne les stéréotypes de genre, mais aussi au niveau d’autres dimensions de la diversité. Néanmoins, un élément doit et devrait encore changer : la représentation des personnes qui ne correspondent pas à une norme binaire de genre reste pratiquement inexistante. Nous voyons certes plus souvent des personnes perçues comme non-blanches, mais elles obtiennent toujours plus rarement des rôles principaux. Ce que l’on ne peut en revanche pas reprocher aux publicités analysées, c’est l’« ageism », c’est-à-dire la discrimination liée à l’âge. Les personnes seniors sont présentées de manière très positive dans la grande majorité des spots », explique Nina Bieli.
Un événement pour réfléchir sur la diversité dans la communication
Le 3 avril prochain au QG Center de Bussigny, le Protocole Gisler et Leading Swiss Agencies organisent un événement afin de réunir les acteurs de la communication pour échanger autour des thématiques de la diversité et de l’inclusion. Au programme, présentation des deux associations, retour sur les résultats de l’analyse des stéréotypes 2024, une conférence de Barbara Fry Henchoz sur le dépassement des clichés dans la publicité, le tout suivi d’un panel de discussion avec différents spécialistes venus du monde des agences de communication. L’événement se clôturera par un moment d’échanges informels.
Aperçu des résultats en chiffres
L’analyse a pris en compte 300 publicités (spots vidéo) qui ont été communiquées en 2024 sur le portail sectoriel persoenlich.com.
Dans 247 de ces publicités, des personnes perçues comme des femmes apparaissent, dans 28 % des cas, elles parlent.
Dans 248 de ces publicités, des personnes perçues comme des hommes apparaissent, et dans 35 % des cas, elles parlent.
→ La proportion de personnes perçues comme masculines et féminines dans les publicités analysées est équilibrée. Les personnes perçues comme masculines ont une part de parole plus importante.
En 2024, 253 des publicités analysées ne contenaient aucun stéréotype. Un ou plusieurs stéréotypes apparaissent dans 47 publicités. Cela correspond à 16 % des spots analysés.
Les stéréotypes féminins sont présents dans 19 des publicités analysées et les stéréotypes masculins dans 35.
Par rapport au nombre total de personnes concernées, les personnes perçues comme des femmes sont stéréotypées dans 7 % des cas, celles perçues comme des hommes dans 11 % des cas.
→ Contrairement aux années précédentes, le nombre de stéréotypes dans les publicités analysées a nettement diminué. Les stéréotypes sont plus souvent volontairement brisés ou associés à un «contre-rôle » (exemple : « l’expert » reçoit « l’experte » en tant que pair).
→ Comme les années précédentes, les personnes perçues en tant qu’hommes sont plus souvent représentées de manière stéréotypée que les personnes perçues comme des femmes.
En 2024, le stéréotype masculin le plus populaire était « Mr. Mansplainer » (14 fois), c’est-à-dire une personne perçue comme un homme qui explique quelque chose, incarnant souvent le rôle d’un expert. Avec son pendant muet, le « maître au travail », les hommes experts sont apparus 22 fois. En deuxième position, on trouve « The One Funny Guy » (11 fois).
En 2024, les experts ont été rejoints par un nombre nettement plus important d’expertes. Des expertes ont pris la parole dans 18 spots. Les personnes drôles perçues comme des femmes étaient cependant aussi rares qu’en 2024. Dans 2 des spots analysés, des personnes perçues comme des femmes apparaissent dans des rôles humoristiques.
Le stéréotype le plus populaire chez les personnes perçues comme des femmes est, comme les années précédentes, « la femme qui s’occupe de tout » (10 fois), bien qu’il y ait également eu une nette augmentation chez les personnes perçues comme des hommes de cette catégorie qui
s’occupent de quelque chose ou de quelqu’un (12 fois).
→ Comme nous l’avons déjà décrit, l’analyse des stéréotypes 2024 a révélé que les stéréotypes de genre étaient moins utilisés et, lorsqu’ils l’étaient, ceci était de manière plus consciente et réfléchie. De plus, les personnes sont souvent représentées dans des rôles et des situations qui étaient jusqu’à présent attribués de manière stéréotypée à l’autre sexe, par exemple des personnes perçues comme masculines qui s’occupent ou des personnes perçues comme féminines en tant qu’expertes.
Le « test de la plante verte » introduit par le Protocole Gisler s’applique à 21 publicités. Si le test s’applique à une publicité, cela signifie qu’une personne perçue au féminin ou une minorité apparaît dans un rôle purement décoratif et sans aucune pertinence pour l’intrigue.
→ La part des spots publicitaires pour lesquels le test des plantes en pot s’applique a encore baissé par rapport à l’année précédente.