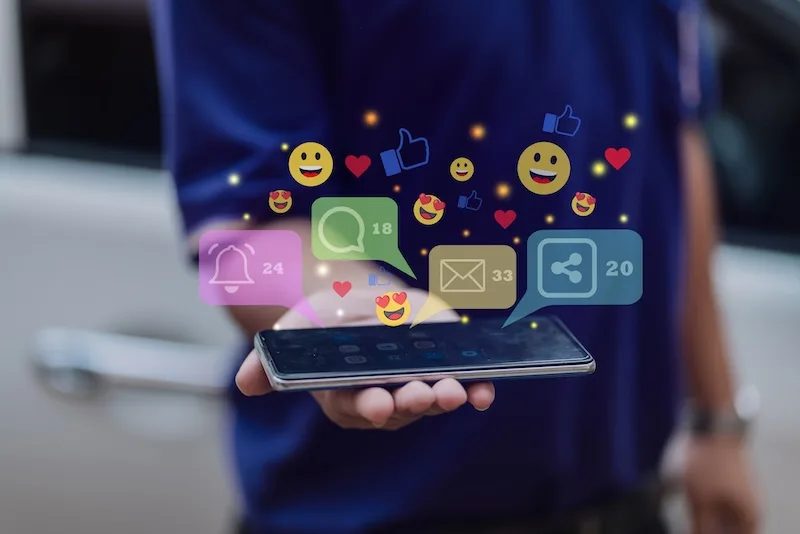Bruxelles durcit le ton contre les géants du numérique. La Commission européenne a annoncé ce mercredi des sanctions financières à l’encontre d’Apple et Meta (maison mère de Facebook et Instagram), pour non-respect des règles de concurrence et de protection des données personnelles. Une décision qui marque la première mise en œuvre concrète du Digital Markets Act (DMA), nouveau règlement européen destiné à encadrer les pratiques des géants du numérique.
Apple écope d’une amende de 500 millions d’euros pour avoir imposé des clauses abusives dans l’App Store, empêchant les développeurs d’applications de communiquer librement avec leurs utilisateurs. Ces restrictions limitaient notamment la possibilité de proposer des offres concurrentes ou des tarifs plus attractifs en dehors de la plateforme d’Apple.
Meta, de son côté, devra s’acquitter de 200 millions d’euros pour avoir combiné des données personnelles issues de différents services (comme Facebook, Instagram et WhatsApp) sans avoir obtenu un consentement explicite de ses utilisateurs. Une pratique en infraction avec le cadre imposé par le DMA. Ces sanctions interviennent un an après le lancement des procédures contre les deux groupes californiens, mais surtout dans un contexte géopolitique délicat : l’Union européenne cherche à obtenir la levée de droits de douane imposés par Donald Trump, toujours très influent dans la politique américaine. En optant pour une simple communication écrite sans conférence de presse, la Commission semble vouloir limiter la tension diplomatique tout en affirmant fermement son autorité.
Réactions contrastées des entreprises
Apple a immédiatement contesté la décision, qu’elle juge « injuste » et ciblée « de manière sélective ». Le géant de Cupertino a annoncé son intention de faire appel, tout en se disant prêt à dialoguer avec les autorités européennes. Meta, quant à lui, a adopté une posture plus conciliante : le groupe de Mark Zuckerberg a déjà proposé une modification de ses pratiques, soumise à l’examen de la Commission. Cette coopération partielle explique une sanction moins lourde que celle infligée à Apple.
Ces amendes, bien que significatives, restent modérées comparées à certaines sanctions antérieures infligées à la tech par Bruxelles. Mais le message est clair : les marges de manœuvre se réduisent pour les grandes plateformes. Si Apple et Meta ne se conforment pas dans un délai de 60 jours, elles risquent des astreintes journalières, ce qui pourrait faire exploser la facture.
Le DMA, en vigueur depuis 2024, vise à mettre fin aux abus de position dominante des « gatekeepers », ces plateformes systémiques qui contrôlent l’accès aux marchés numériques. Ce texte emblématique s’inscrit dans la volonté de l’Europe de reprendre la main sur son écosystème numérique et de défendre un modèle plus respectueux des utilisateurs, des développeurs et des règles du marché.
Une Europe plus offensive sur la tech
La double sanction infligée à Apple et Meta confirme une tendance : l’Europe s’émancipe de la dépendance technologique américaine, et entend bien imposer ses règles. Une ambition qui pourrait transformer durablement le paysage numérique mondial, à l’heure où la régulation devient un enjeu stratégique autant qu’économique.
ENCADRE: Droits voisins : comment mieux encadrer les réseaux sociaux au bénéfice des éditeurs et créateurs de contenus ?
Alors que les réseaux sociaux occupent une place centrale dans la diffusion de l’information, la question du respect des droits voisins reste plus que jamais d’actualité. Si la directive européenne de 2019 a jeté les bases d’un partage de la valeur entre les plateformes numériques et les éditeurs de presse, son application demeure inégale, voire insuffisante face à la puissance des géants du numérique. À l’heure où l’UE se montre plus offensive dans la régulation des marchés numériques, quelles pistes peuvent être envisagées pour renforcer le contrôle des réseaux sociaux dans le respect des droits des éditeurs et des créateurs ?
Imposer la transparence des plateformes : Les réseaux sociaux diffusent massivement des contenus issus des médias sans toujours en partager les bénéfices. Pour les éditeurs, difficile de savoir combien de fois leurs contenus sont relayés, comment ils sont monétisés, ou quel revenu exact cela génère. L’instauration d’une obligation de transparence permettrait aux éditeurs de mieux faire valoir leurs droits. Il s’agirait notamment d’imposer la publication de rapports réguliers détaillant les usages des contenus de presse et les revenus associés.
Intégrer les droits voisins dans les systèmes de partage : À l’image du Content ID de YouTube, les réseaux sociaux devraient intégrer des mécanismes techniques capables d’identifier automatiquement les contenus soumis aux droits voisins. Une telle mesure permettrait un déclenchement automatique de la rémunération ou, à défaut, le blocage du contenu litigieux. L’objectif étant de faire en sorte que les droits suivent les contenus, quels que soient le mode ou la plateforme de diffusion.
Encadrer les négociations : vers un arbitrage équitable : Aujourd’hui, les accords passés entre plateformes et éditeurs sont souvent opaques et déséquilibrés, bénéficiant surtout aux grands groupes. Pour éviter la marginalisation des petits acteurs, il devient urgent d’encadrer juridiquement les négociations. Une autorité de régulation indépendante pourrait fixer des barèmes minimaux de rémunération, arbitrer les litiges, et garantir des conditions de négociation équitables, sur le modèle de l’ARCOM en France.
Harmoniser l’application à l’échelle européenne : Malgré la directive européenne de 2019, les États membres avancent à des vitesses différentes. Certains pays peinent encore à faire appliquer les droits voisins, ce qui fragilise l’ensemble du dispositif. La création d’une agence européenne dédiée aux droits voisins permettrait d’harmoniser l’application du texte, de centraliser les litiges transfrontaliers, et d’assurer un traitement équitable des éditeurs, quelle que soit leur nationalité.
Protéger les journalistes indépendants : Les bénéficiaires des droits voisins sont majoritairement des éditeurs ou groupes de presse. Or, une part croissante de l’information en ligne est produite par des journalistes indépendants, souvent exclus des accords de rétribution. L’une des pistes consisterait à ouvrir des mécanismes de redistribution spécifiques, via des sociétés de gestion collective ou des fonds alimentés par les plateformes, pour garantir une rémunération juste à tous les contributeurs.
Renforcer les sanctions contre les plateformes récalcitrantes : Sans mesures coercitives fortes, les droits voisins resteront lettre morte. Aujourd’hui, peu de sanctions sont appliquées en cas de non-respect ou d’inaction des plateformes. Il faudrait prévoir des sanctions financières progressives, voire des restrictions temporaires sur la publicité ou la monétisation pour les plateformes non coopératives.
Vers un nouvel équilibre numérique : Dans un écosystème dominé par quelques grandes plateformes, le respect des droits voisins représente une avancée décisive pour la pérennité du journalisme et de la création de contenus. Mais pour que ces droits deviennent réellement effectifs, ils doivent s’accompagner de règles claires, d’outils technologiques adaptés et d’une volonté politique forte.
Les prochaines étapes seront cruciales. Car au-delà des enjeux juridiques ou économiques, il s’agit de défendre un modèle d’information pluraliste et durable, où les créateurs de valeur sont justement rémunérés, quels que soient les canaux par lesquels leurs contenus circulent.
Réaction de Washington
un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que les États-Unis «ne toléreront pas» ces lourdes amendes infligées par l’Union européenne qualifiées comme une «nouvelle d’extorsion économique». Affaire à suivre !