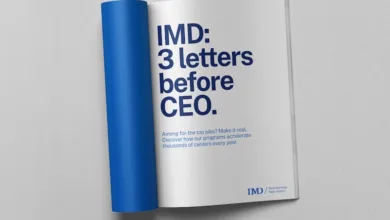La vision du paysage médiatique suisse de Pietro Supino

Dans une prise de position approfondie, Pietro Supino, éditeur chez Tamedia et président du TX Group, appelle à une politique médiatique pragmatique et éclairée. À travers une métaphore tirée d’une chanson de Mani Matter — des passagers de train qui s’opposent en regardant dans des directions opposées — il critique l’atmosphère idéologique et polarisée du débat actuel, y compris dans le domaine des médias.
Mutation structurelle et révolution technologique
Pietro Supino rappelle que la transformation des médias est d’abord une conséquence de l’évolution technologique : de la presse imprimée à la numérisation, les coûts de production ont chuté, ouvrant la porte à une multiplication des contenus. Aujourd’hui, les institutions, les entreprises, et même les particuliers sont devenus des éditeurs à part entière. L’essor de l’intelligence artificielle accélère encore cette dynamique, tout en renforçant la position dominante des grandes plateformes mondiales.
Indépendance journalistique et fonction démocratique
L’éditeur souligne le rôle fondamental du journalisme professionnel : informer, contrôler les pouvoirs, et garantir un débat public éclairé. Il plaide pour une pratique journalistique fondée sur la rigueur, l’indépendance et la distance critique — valeurs mises à mal par les logiques de dépendance, que ce soit vis-à-vis de l’État ou des intérêts économiques.
Pour une aide publique ciblée et non intrusive
Il défend une aide indirecte à la presse (par exemple via la distribution postale ou le soutien aux agences de presse), qu’il juge efficace car neutre sur le contenu éditorial. En revanche, il critique les formes d’aide directe, estimant qu’elles risquent d’entamer la liberté de la presse et de créer une forme de complaisance ou d’autocensure.
Des médias en compétition déséquilibrée
L’un des points centraux de sa critique porte sur la SSR. Pietro Supino appelle à une stricte complémentarité entre l’audiovisuel public et l’offre privée, afin d’éviter toute concurrence biaisée par la redevance. Il propose de limiter les activités numériques de la SSR aux contenus audiovisuels, et d’ouvrir les productions publiques en open source.
Publicité, interdictions et droit voisin
Il met également en garde contre les interdictions publicitaires croissantes, qui affaiblissent le modèle économique des médias suisses tout en favorisant la fuite des investissements vers les plateformes étrangères. Il défend la mise en place urgente d’un droit voisin, afin de protéger les investissements journalistiques face à l’exploitation gratuite de leurs contenus par les géants du numérique et l’IA.
Un appel à la responsabilité collective
En conclusion, cet éditeur appelle les autorités, les institutions et les citoyens à soutenir les médias suisses de manière concrète — en souscrivant à des abonnements ou en plaçant de la publicité — plutôt que de s’en remettre à des subventions à fonds perdus. Il encourage le secteur à miser sur l’innovation, la qualité, et l’adaptation aux nouveaux usages. Selon lui, la crédibilité et la viabilité des médias se gagnent d’abord par l’engagement entrepreneurial et non par la dépendance étatique.
Que penser que cette tribune ? L’avis de Cominmag
Lorsqu’un acteur comme TX Group, premier groupe de presse privé de Suisse, met en garde contre les risques d’une aide directe aux médias, il est nécessaire de rappeler que cette entreprise dispose d’un quasi-monopole dans plusieurs régions. Peut-on encore parler de « liberté de la presse » si cette dernière dépend essentiellement de la santé financière d’un acteur privé unique ? En refusant tout soutien direct, Supino défend en réalité un statu quo qui favorise les géants du secteur — dont le sien. En effet, cet article reste étonnamment silencieux sur la question de la concentration des titres, des rédactions et des régies publicitaires. À force de fusions, de centralisations rédactionnelles et de fermetures de titres locaux, le modèle économique du journalisme s’est appauvri. L’aide publique pourrait précisément servir à corriger ces déséquilibres, en soutenant l’émergence de nouvelles voix, de médias indépendants, ou de projets locaux.
Associer mécaniquement dépendance économique et liberté éditoriale est un raccourci discutable. De nombreux médias à but non lucratif, subventionnés ou soutenus par des fondations, produisent un journalisme d’enquête exemplaire. Ce qui compte, ce n’est pas uniquement la provenance des fonds, mais la gouvernance, la transparence et les garde-fous mis en place. Les exemples allemands, scandinaves ou canadiens montrent qu’une aide publique bien conçue ne mène ni à l’autocensure ni à la perte de crédibilité.
L’attaque contre SSR pour qu’elle se retire du numérique pour « ne pas concurrencer » les médias privés ne tient pas compte des usages actuels : l’information passe aujourd’hui par des canaux multiples, et priver le service public d’un accès numérique revient à le condamner à l’obsolescence. En outre, les contenus de la SSR visent des missions de service public qui ne sont ni couvertes, ni même visées par les éditeurs privés. Ce n’est pas en affaiblissant la SSR qu’on renforcera la diversité du paysage médiatique.
Enfin, Pietro Supino a raison de rappeler que la transformation des médias passe par l’innovation et des investissements constants. Mais encore faut-il que ces investissements ne soient pas réservés aux seuls groupes disposant de marges suffisantes. Aujourd’hui, les petits éditeurs, les médias associatifs ou à but non lucratif jouent un rôle fondamental dans la couverture de certaines thématiques ou régions oubliées. Ils méritent autant — sinon plus — d’attention que les grands groupes.